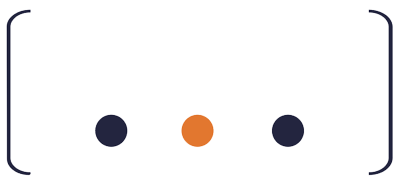Ruptures et changement
11 janvier 2021
Tout n’est pas foutu
4 février 2021La vie nue

Depuis un an, les consignes sanitaires gouvernementales contraignent drastiquement les dimensions relationnelles et sociales de nos existences.
Les médias, quant à eux, véhiculent jusqu’à saturation des images de corps soumis à des prélèvements, des injections et des intubations, qui nous immergent dans un imaginaire d’hospitalisation généralisée.
Devons-nous nous étonner du développement des situations de détresse psychique, qui se multiplient de façon exponentielle ?
Après la deuxième guerre mondiale, le psychiatre et psychanalyste René Spitz a mis en évidence l’importance fondatrice des interférences affectives dans le développement du jeune enfant, interférences qui passent par les gestes et les paroles.
Il a nommé hospitalisme l’état dépressif grave qui se manifeste chez certains enfants lorsqu’ils sont privés de tout lien d’affection dans le cadre d’une hospitalisation prolongée.
Lorsque ne sont apportés à ces jeunes enfants que les soins nécessaires pour le corps biologique, c’est-à-dire pour la survie, la privation des gestes et des paroles véhiculant les affects va jusqu’à produire des atteintes au corps lui-même (perte de poids, arrêt du développement) et peut mener jusqu’à la mort.
Cette notion d’hospitalisme donne un éclairage à l’obsessionalisation actuelle sur la vie biologique en tant qu’elle pourrait se dispenser durablement des dimensions relationnelles et affectives.
À l’échelle de la planète, voilà un symptôme inédit.
Pour penser ce phénomène, nous pouvons prendre appui sur ce que le philosophe Giorgio Agamben appelle la vie nue.
En grec, il y a deux mots pour désigner la vie.
Il y a bios, qui désigne la vie humaine, la façon proprement humaine de vivre d’une personne ou d’un groupe.
Et il y a zôé qui désigne le simple fait de vivre, commun à tous les êtres vivants, humains ou animaux.
Zôé, une vie nue, détachée de la parole, des symboles, des gestes qui fondent l’humain.
Bien avant la crise sanitaire actuelle, tout le vingtième siècle, selon Giorgio Agamben, a vu le pouvoir politique, s’appuyant pour cela sur le discours scientifique, rabattre les vies humaines sur leur seule dimension de vie nue, devenant l’unité de compte de toute gestion collective.
D’où l’enjeu, quelle que soit leur échelle, possiblement infinitésimale, à ouvrir dans les contextes sociaux, professionnels ou privés, des espaces faisant place au symbolique et à l’acte toujours nécessaire de parole incarnée et de création du sens.
Daniel Migairou, janvier 2021